Les Aventures d’Alice au Pays des Merveilles deviennent rapidement très populaires : avec le temps, elles apparaissent aujourd’hui comme l’œuvre majeure de son auteur Lewis Carroll. Il convient donc de présenter maintenant l’écrivain, puis son héroïne.
 Lewis
Carroll, dont le véritable nom est Charles Lutwidge Dodgson, est né à Daresbury
(près de Manchester, Angleterre) en 1832. Fils d’un prêtre de l’Église anglicane
ministre de sa paroisse, il est le troisième d’une famille de onze enfants.
Son enfance, qui se déroule à Daresbury puis, à partir de 1843, à Croft dans
le Yorkshire, est ponctuée de diverses activités à vocation artistique, telles
que spectacles de marionnettes, ou plus tard création d’un journal satirique
(« The Rectory Magazine » 1,
à usage familial, qu’il crée vers 1850 avec ses frères et sœurs). Envoyé en
pension à Richmond à l’âge de douze ans, Charles Lutwidge Dodgson entre peu
après à la célèbre public school de Rugby : là, malgré les difficultés
que représentent pour lui le régime des punitions et la vie collective, il
réussit de brillantes études qui le conduisent au Christ Church College d’Oxford
en janvier 1851.
Lewis
Carroll, dont le véritable nom est Charles Lutwidge Dodgson, est né à Daresbury
(près de Manchester, Angleterre) en 1832. Fils d’un prêtre de l’Église anglicane
ministre de sa paroisse, il est le troisième d’une famille de onze enfants.
Son enfance, qui se déroule à Daresbury puis, à partir de 1843, à Croft dans
le Yorkshire, est ponctuée de diverses activités à vocation artistique, telles
que spectacles de marionnettes, ou plus tard création d’un journal satirique
(« The Rectory Magazine » 1,
à usage familial, qu’il crée vers 1850 avec ses frères et sœurs). Envoyé en
pension à Richmond à l’âge de douze ans, Charles Lutwidge Dodgson entre peu
après à la célèbre public school de Rugby : là, malgré les difficultés
que représentent pour lui le régime des punitions et la vie collective, il
réussit de brillantes études qui le conduisent au Christ Church College d’Oxford
en janvier 1851.
Cette même année, Charles est très affectée par la mort de sa mère, ce qui contribue à rendre très difficiles des relations paternelles déjà peu favorables. Il se plonge néanmoins dans le travail, et obtient son diplôme de mathématiques en décembre 1854. Dès lors, il devient très vite un « membre du collège », c’est-à-dire l’équivalent d’un assistant de faculté aujourd’hui : ce nouveau rôle, qui le contraint à devenir prêtre et à rester, du moins provisoirement, célibataire, ne fait que renforcer un isolement qui le caractérise déjà fortement.
Il commence à écrire sérieusement : d’abord des poèmes, mais aussi des nouvelles qui parurent dans un petit magazine, The Train. C’est d’ailleurs le directeur de cette revue qui l’aida à lui trouver un pseudonyme, celui de Lewis Carroll en 1856. Parallèlement, il se passionne pour la photographie, une technique encore balbutiante : c’est ainsi qu’il commence à réaliser ses premiers portraits de petites filles, dont Alice Liddell, l’une des trois filles du doyen de son collège.
Il est très attaché aux fillettes, à qui il raconte pour la première fois en 1862, lors d’une promenade en barque, ce qui allait devenir les aventures d’Alice au pays des merveilles. À la demande d’Alice Liddell, à qui le premier manuscrit du conte est spécialement adressé, une édition en fac-similé en fut réalisée presque aussitôt, constituant Les aventures d’Alice sous terre, illustrées par Lewis Carroll 2. Le texte fut ensuite largement augmenté et arrangé, puis parut chez l’éditeur Macmillan en juillet 1865. Ce livre, intitulé Alice au pays des merveilles et illustré par le caricaturiste John Tenniel, fut immédiatement un grand succès 3. Carroll envisagea alors une « suite » intitulée De l’autre côté du miroir (et ce qu’Alice y trouva), encore assortie des illustrations de Tenniel, qui parut en 1872. Fort de ce nouveau succès, Carroll fit publier en 1876 La Chasse au Snark, qui connut une gloire pratiquement équivalente.
Parallèlement, nous pouvons évoquer les activités de Carroll en tant que professeur et mathématicien : dans ce domaine son enseignement ne plaît guère, et ses ouvrages n’ont pas la réussite de ses œuvres littéraires. Sa timidité et son bégaiement lui servent de prétexte pour refuser le titre de prêtre, après qu’il eut été ordonné diacre en 1861. Même s’il parvient à rester à Christ Church, où sa vie se déroulait calmement, un violent conflit l’oppose désormais au doyen Liddell, d’une part inquiet de son attachement pour Alice (qui a vingt ans en 1872), et d’autre part exaspéré par ses pamphlets virulents envers plusieurs autorités d’Oxford (1874) 4.
Carroll renonce finalement à tout type d’enseignement en 1881 et abandonne également la photographie, peut-être sous l’influence de reproches adressés à son goût pour les portraits de petites filles en déshabillé. La logique devient dès lors son passe-temps favori et l’objet de la plupart de ses livres 5, si l’on excepte Sylvie et Bruno, œuvre de fiction parue en deux parties (en 1889 et 1893).
Enfin, pour signaler quelques traits caractéristiques de la personnalité de Lewis Carroll, il faut noter qu’il refusa constamment l’identification Dodgson-Carroll : pour lui en effet, il existait l’homme privé Dodgson et l’homme public Carroll. Néanmoins, c’est sous ce dernier nom qu’il se présentait aux nombreuses petites filles avec qui il lui arrivait souvent d’entrer en conversation, sur la plage ou dans le train. Une volumineuse correspondance démontre à ce propos qu’il lui arrivait fréquemment d’engager des relations plus profondes avec ces amies. En définitive, on constate qu’elles furent en fait l’essentiel de ses amitiés, et sans doute les êtres les plus affectés lorsqu’il mourut dans sa famille le 14 janvier 1898 à l’âge de soixante-six ans.
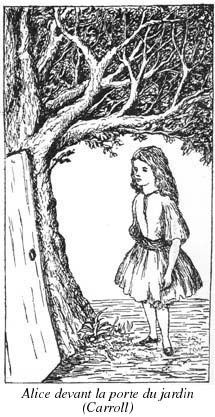 Comme
nous l’avons dit, le texte auquel nous allons maintenant nous référer
est sans doute le plus célèbre de Lewis Carroll. Son élaboration
résulte de plusieurs étapes importantes. La première,
c’est bien sûr cette promenade en barque du 4 juillet 1862, durant
laquelle Carroll commence à raconter aux trois petites filles Liddell,
Alice (10 ans), Lorina (13 ans) et Edith (8 ans), une étrange histoire.
Par la suite, Carroll reprendra son récit à deux reprises, toujours
au cours de ballades, au mois d’août 1862 : Alice, émerveillée,
lui demande alors d’écrire le conte, ce que Carroll entreprend
assez rapidement.
Comme
nous l’avons dit, le texte auquel nous allons maintenant nous référer
est sans doute le plus célèbre de Lewis Carroll. Son élaboration
résulte de plusieurs étapes importantes. La première,
c’est bien sûr cette promenade en barque du 4 juillet 1862, durant
laquelle Carroll commence à raconter aux trois petites filles Liddell,
Alice (10 ans), Lorina (13 ans) et Edith (8 ans), une étrange histoire.
Par la suite, Carroll reprendra son récit à deux reprises, toujours
au cours de ballades, au mois d’août 1862 : Alice, émerveillée,
lui demande alors d’écrire le conte, ce que Carroll entreprend
assez rapidement.
Ainsi, un premier manuscrit intitulé Alice’s adventures under ground (« Les aventures d’Alice sous terre », parfois traduit « Les aventures souterraines d’Alice ») voit le jour ; agrémenté de 37 illustrations de Carroll, il est offert par ce dernier à Alice le 26 novembre 1864. Devant l’enthousiasme de ses amis Robinson Duckworth (qui était présent lors des promenades en barque) et Georges MacDonald, poète et romancier, Carroll songe de plus en plus sérieusement à faire éditer ce conte de manière « professionnelle ». Il entre donc en contact avec l’éditeur Macmillan 6, et passe une douzaine de mois à arranger son premier texte, qui passe de 18 000 à 35 000 mots. Courant 1864, Macmillan accepte de le publier, mais Carroll prend en charge les frais d’illustrations : c’est ainsi qu’il choisit John Tenniel, avec qui il sera d’une rigueur draconienne, l’accablant de directives très strictes, illustrant pratiquement le livre par procuration…7
L’ouvrage, qui s’intitule désormais Alice au pays des merveilles, est d’abord tiré à 2000 exemplaires en juin 1865, puis, sous la demande de Tenniel qui trouve l’impression de ses illustrations déplorable, un deuxième tirage à 5000 exemplaires est effectué au moment de Noël. Comme nous l’avons vu, le livre connaît un succès presque immédiat, et les critiques sont dans l’ensemble positives. Ainsi, The Spectator écrit : « les grandes personnes qui l’offriront à leur progéniture se retrouveront en train d’en lire davantage qu’elles n’en avaient l’intention et de rire plus qu’elles n’étaient en droit de s’y attendre » ; de même, le 25 mai 1866, The Sunderland Herlad s’enthousiasme : « Ce livre joli et drôle devrait obtenir un grand succès auprès des enfants. Il a l’avantage d’être dépourvu de tout aspect moralisateur ou didactique. C’est, en somme, du sucre d’un bout à l’autre, sans rien de ce goût amer qui, pour certains, devrait être à la base de tous les livres pour enfants. »
Signalons qu’au fur et à mesure que le livre est élaboré et obtient du succès, les relations entre Carroll et Alice Liddell ne vont qu’en se détériorant, ceci en grande partie à cause de Mme Liddell, la mère d’Alice et grande ennemie de Carroll, qui tient ses enfants à l’écart de l’écrivain.
À titre anecdotique, il est intéressant de remarquer l’attachement particulier que Carroll avait pour son éditeur Macmillan, allant jusqu’à demander ouvertement un avantage pécuniaire plus important pour l’éditeur que pour le libraire, estimant que « la contribution de l’éditeur est aussi importante que celle du libraire en matière de temps et d’effort physique, mais l’effort et le souci intellectuels sont infiniment plus grands. » 8
Pour qui ne sait plus exactement ce qu’attend Alice dans le terrier du lapin ou ne l’a tout simplement jamais su, un résumé du livre s’impose. Le texte de Lewis Carroll est divisé en 12 chapitres. Il raconte les aventures d’une petite fille dans un pays peuplé de créatures étranges, dont voici le détail chapitre par chapitre : 9
• Chapitre 1 : Descente dans
le terrier du lapin
La grande sœur d’Alice lui lit un livre ennuyeux, quand soudain passe en courant
un lapin blanc : Alice le poursuit dans son terrier et après une longue chute
se retrouve dans une pièce souterraine. Là, sur une table, elle trouve un
petit flacon avec l’indication « bois-moi ». Alice boit le contenu du flacon
et rétrécit. Elle mange ensuite un gâteau qui se trouvait sous la table, dans
une boîte avec l’indication « mange-moi ». Elle s’attend à grandir, mais il
ne se passe rien.
• Chapitre 2 : La mare aux larmes
Le gâteau fait son effet, et Alice grandit. Elle se met à pleurer, voit repasser
le Lapin, puis rapetisse à nouveau. Elle se retrouve alors dans ses larmes,
qui forment une véritable mare. Là, elle voit passer plusieurs types d’animaux
qui nagent avec elle : d’abord une souris, avec qui elle regagne la terre
ferme, puis plusieurs autres animaux directement inspirés des personnes présentes
lorsque Carroll raconta l’histoire aux petites filles Liddell : un Canard
(duck, pour Robinson Duckworth), un Dodo (pour Dodgson), un Lori (pour
Lorina Liddell) et un Aiglon (eaglet pour Edith Liddell).
• Chapitre 3 : Une course à
la Comitarde et une longue histoire
Alice et l’assemblée d’animaux se concertent afin de se sécher, ce qui fait
penser à une parodie de réunion politique, puis le Dodo propose une course
à la Comitarde; lorsque tout le monde a suffisamment couru et que tout le
monde est sec, le Dodo déclare que tout le monde a gagné. Il prend alors un
dé à coudre dans la poche d’Alice pour lui remettre solennellement en guise
de prix. Ensuite, la Souris raconte une longue histoire qui apparaît dans
le livre comme un Calligramme en forme de queue de souris, et dont le corps
des caractères se rétrécit progressivement. Ceci a pour effet d’engourdir
le lecteur qui ne lit pas l’histoire jusqu’au « bout » : cette sensation d’inattention
est rapportée à Alice, quand la Souris croit qu’elle ne l’écoute plus. La
Souris, vexée, s’en va, ainsi que tous les autres animaux : Alice se retrouve
toute seule.
• Chapitre 4 : Le Lapin fait
donner le petit Bill
Le Lapin Blanc revient et interpelle Alice sous le nom de « Marianne » : Alice
entre alors dans la maison du Lapin, boit une seconde bouteille et se remet
à grandir. Alice, coincée dans la maison, entend ensuite le Lapin envoyer
l’un des ses domestiques, Bill, dans la cheminée : lorsqu’il est dedans, Alice
lui donne un coup de pied qui le fait sortir de la cheminée et voler dans
les airs. Les autres lui jettent ensuite des cailloux qui se transforment
en gâteaux. Alice en mange un et rétrécit : elle s’enfuit, rencontre un petit
chiot puis plus tard un ver à soie fumant un narguilé sur un champignon.
• Chapitre
5 : Les conseils du Ver à soie
Alice parle avec le Ver à soie, puis lui récite le poème « Vous êtes vieux,
Père William », qu’elle déforme complètement 10.
Le Ver disparu, elle découpe ensuite deux bouts de champignon, espérant retrouver
sa taille normale en les mangeant : avec le premier, sa tête se retrouve au
niveau de ses chaussures (son corps disparaît), et avec le second, son cou
s’allonge terriblement et sa tête se retrouve au dessus des arbres. Là, elle
discute avec un pigeon qui la prend pour un serpent (nouveau problème d’identité),
puis se décide à grignoter progressivement ce qui lui reste de morceaux de
champignon, jusqu’à retrouver une taille de vingt centimètres (« pour ne pas
effrayer les gens qui habitent ici »).
 •
Chapitre 6 : Cochon et poivre
•
Chapitre 6 : Cochon et poivre
Dans ce chapitre, Alice entend pour la première fois parler de la Reine, et
rentre chez la Duchesse. Dans la maison, il y a un chat du comté de Chester
11, une cuisinière et
la Duchesse qui berce (en le secouant violemment) un bébé qu’elle appelle
« Cochon » : au bout d’un moment, Alice se voit confier le bébé, s’en va avec
lui, et celui-ci se transforme en cochon. Elle le laisse sur sa route, puis
rencontre le chat du comté de Chester (qui possède un sourire figé) sur une
branche, parle avec lui et demande son chemin. Le Chat lui explique les différentes
routes et disparaît : Alice s’avance ensuite vers la maison du Lièvre de Mars.
• Chapitre 7 : Un thé chez les
fous
Dans ce chapitre, Alice
boit une tasse de thé en compagnie du Chapelier, du Lièvre de
Mars et du Loir : les explications absurdes et insensées s’enchaînent
(« Pas du tout la même chose ! protesta le Chapelier. Tant que
vous y êtes, vous pourriez aussi bien dire que " Je vois ce que je mange
", c’est la même chose que " Je mange ce que je vois ! " »)
et Alice finit par s’en aller, tandis que le Lièvre et le Chapelier
tente de rentrer le Loir dans la théière. Alice retrouve ensuite
la pièce du Chapitre 1, prend la clé qui est sur la table et
ouvre une petite porte de vingt centimètres : en mangeant du champignon,
elle rétrécit encore et passe par la porte pour arriver dans
un grand jardin lumineux.
• Chapitre 8 : Le terrain de
croquet de la Reine
Alice est confrontée à trois jardiniers en forme de cartes à jouer peignant
des roses blanches en rouge : la Reine les surprend et ordonne qu’on leur
coupe la tête. Ensuite, une partie de croquet est engagée, dans laquelle les
maillets sont des flamands vivants, les boules des hérissons et les arceaux
des soldats courbés en deux. Pendant la partie, où la Reine gagne en trichant,
la tête du Chat réapparaît. S’en suit une controverse entre le Roi, la Reine
et le bourreau quant à la manière de couper une tête sans corps (celle du
Chat).
• Chapitre
9 : Histoire de la Tortue « Fantaisie » 12
Alice rencontre pour la deuxième fois la Duchesse, puis la Reine présente
à Alice le Griffon (tête et corps d’aigle, pattes de chien et oreilles de
renard) et la Tortue « Fantaisie » (tortue à tête de veau, pieds de cochon
et queue de vache) : Alice engage avec eux une conversation truffée de jeux
de mots - par exemple : « He taught Laughing and Grief. » (« Il enseignait
le Rire et le Chagrin. »), où il faut substituer d’autres mots dont la prononciation
est analogue, à savoir : « He taught Latin and Greek. » (« Il enseignait
le Latin et le Grec. ») -.
• Chapitre 10 : Le quadrille
des homards
La Tortue « Fantaisie » et le Griffon raconte ensuite à Alice comment se danse
le quadrille des homards, puis Alice propose de leur raconter son histoire
depuis sa chute dans le terrier du Lapin. Arrivée à l’anecdote de la poésie
transformée « Vous êtes vieux, Père William », elle essaie de réciter d’autres
poésies qui sont une fois de plus transformées par sa bouche. La Tortue «
Fantaisie » décide de lui réciter une vraie poésie, mais elle est interrompue
par l’annonce du début d’un procès.
 •
Chapitre 11 : Qui a dérobé les tartes ?
•
Chapitre 11 : Qui a dérobé les tartes ?
Alice assiste au procès, où réapparaissent plusieurs personnages rencontrés
au fil de son aventure : le Lapin Blanc ; le Roi (qui fait le juge) ; la Reine
; Bill le lézard (qui fait parti du jury) ; Le Chapelier, Le Loir et le Lièvre
de Mars (tous les trois témoins) ; la cuisinière. Soudain, Alice se remet
à grandir, puis le Lapin Blanc la cite comme témoin.
• Chapitre 12 : La déposition
d’Alice
Alice, qui a grandi, commence par renverser le banc des jurés, puis
est accusée par le Tribunal. Une discussion est commencée pour
savoir si oui ou non Alice est coupable : la Reine finit par ordonner qu’on
lui coupe la tête, au moment où Alice a retrouvé sa taille
normale. Les cartes à jouer se jettent néanmoins sur elle, et
Alice se réveille couchée sur un talus, la tête sur les
genoux de sa sœur. Le texte se termine par l’évocation d’une
« vision » de la grande sœur qui imagine les personnages
du rêve d’Alice et retombe ainsi en quelque sorte dans l’enfance.
Pour commenter succinctement le contenu de ce texte, il est aujourd’hui indéniable que ce livre de Carroll consacra l’un des temps forts de la littérature anglaise du XIXe siècle, c’est-à-dire la littérature de l’absurde et du nonsens, préétablie en 1858 par un autre poète-dessinateur anglais, Edward Lear (et son livre Book of Nonsense). En effet, on trouve d’abord dans le texte de Carroll une expérience du rêve qui permet peu à peu au lecteur de quitter le terrain de l’expérience et de la « réalité », et ce grâce à des invraisemblances touchant au temps et à l’espace, ainsi qu’à la logique.
On trouve également des effets comiques qui permettent au lecteur, en riant ou non, d’accepter ou non un passage vers le monde carrollien, rendant possible une complicité progressive avec l’auteur. Peu à peu, au fil des jeux de mots et des idées farfelues, le lecteur finit par bannir tout jugement objectif et accepter un monde qu’il aurait rejeté comme absurde si l’auteur lui avait demandé d’y croire d’emblée. Ces indications sont précieuses, car comme nous le verrons notamment dans la deuxième partie de cette étude, l’interprétation du récit par ses illustrateurs n’a pas forcément suivi l’écrivain dans son extravagante transgression des lois de l’objectivité…
1
à ce sujet, voir Carroll dessinateur ![]()
2
ces dessins sont étudiés en détail dans la partie intitulée À l'origine,
Carroll et Tenniel, le rapport des images au récit
![]()
3
« Alice » fut en effet réédité très rapidement en 1866, 1867, 1868, 1872 puis
1874. ![]()
5
Une Histoire compliquée (1885), The Game of Logic (1887), Pillow
Problems (1893), et de nombreux petits textes comme : Ce que la tortue
dit à Achille (1894) ![]()
6
la maison d’édition Macmillan and Co. est l’une des plus anciennes maisons
d’édition d’Angleterre, fondée à Cambridge en 1843 par Daniel et Alexander
Macmillan, puis installée à Londres en 1858 ; elle correspond aujourd’hui
à l’un des groupes les plus importants (et les plus influents) de l’édition
anglaise, Macmillan Publishers (comprenant Macmillan Press, Pan Macmillan,
Papermac, Sidgwick & Jackson, Pan (Picador & Piccolo)) ![]()
7
La recherche d’un illustrateur professionnel par Carroll, puis sa rencontre
avec Tenniel, est arrangée par Tom Taylor, auteur dramatique et comique très
en vogue à l’époque. ![]()
8
extrait d’un petit tract rédigé par Carroll en 1883, rapporté par son neveu
S.D. Collingwood ![]()
9
les plus entreprenants peuvent aussi se reporter à l’édition
online du livre (en anglais) ![]()
10
La plupart des poésies contenues dans le livre n’ont pas été inventées par
l’auteur : Lewis Carroll, en les écrivant, a en fait parodié des poésies enfantines,
généralement à tendance moralisatrice, que tous les écoliers et écolières
d’Angleterre savaient par cœur à cette époque. ![]()
11
traduit aussi comme le Chat du comté de Cheshire par Henri Parisot ![]()
12
la Tortue « Fantaisie », comme l’a traduit Henri Parisot, a été traduit «
Simili-Tortue » par Jacques Papy ![]()